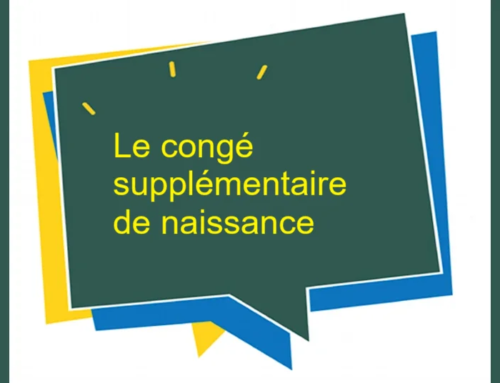Instaurée par la loi sur la réforme des retraites d’avril 2023, la mise en œuvre de la retraite progressive est précisée par un décret paru en août 2023. Ce dispositif, souvent présenté comme la réminiscence du dispositif de Cessation Progressive d’Activité, s’en différencie par bien des aspects. D’une part, ce n’est pas un droit car il est conditionné à l’obtention d’un temps partiel. D’autre part, financièrement, le montant de la “pension partielle” versée est inférieur à celui d’un salaire continué.
Pour toute demande d’explication ou aide, contactez-la FSU-SNUipp 86.
Sommaire
- 1 Principe
- 2 Conditions
- 3 Modalité de dépôt de la demande
- 4 Modalité de calcul et de versement du montant de la retraite progressive et possibilité de modification
- 5 Fin du dispositif
- 6 Prise en compte de la période de la retraite progressive dans le calcul de la pension
- 7 Quelques précisions
- 8 Notre analyse
Principe
Il s’agit de donner la possibilité, sous conditions, de diminuer son temps de travail dès 60 ans. Le salaire perçu au regard du temps partiel est complété par une pension partielle. Celle-ci est calculée sur la base de la pension à laquelle le/la fonctionnaire aurait droit, à la date du début de la retraite progressive, affectée d’un coefficient égal à la quotité non travaillée.
Conditions
Trois conditions sont fixées :
- avoir 60 ans ;
- disposer d’au moins 150 trimestres d’assurance, tous régimes confondus, à date de la demande ;
- disposer d’un temps partiel de droit ou sur autorisation (entre 50% et 90%). Concrètement, la période de la vie concernée par ce dispositif limite l’accès aux temps partiels de droit aux seuls situations de bénéficiaires d’obligation d’emploi de travailleurs handicapés (BOETH), d’adoption ou de soins à un membre de la famille (enfants, conjoint.e, parents, grands-parents, arrière grands-parents). Dans la majorité des cas, il faudra donc obtenir un TP sur autorisation. Cela donne à l’administration une large marge de manœuvre pour que ce droit ne soit pas effectif car, si réglementairement l’employeur ne peut s’opposer au bénéfice de la “retraite progressive”, il peut limiter l’accès au TP sur autorisation.
Modalité de dépôt de la demande
Plusieurs situations :
- la/le collègue dispose d’un temps partiel ou est assuré.e de disposer d’un temps partiel : il/elle fait sa demande au SRE (Service de Retraite de l’Etat). Attention, la durée de traitement par cette instance peut être longue (6 mois), il est donc recommandé d’anticiper sa demande par rapport à la date d’obtention de ce dispositif. A défaut, la retraite progressive sera versée après le droit effectif ouvert mais avec rattrapage des arriérés.
- la/le collègue ne dispose pas de temps partiel : il/elle en fait la demande et déclenche en même temps une demande d’obtention de retraite progressive auprès du SRE.
Si, par avis motivé, le SRE refusait le dispositif de la retraite progressive (il ne pourrait s’agir que de situation où l’agent.e ne réunit pas les conditions énoncées au point 2), l’agent.e pourra demander la fin de son temps partiel dans les conditions de droit commun (annulation d’une décision créatrice de droit) sans que l’administration ne soit dans l’obligation d’y satisfaire.
Modalité de calcul et de versement du montant de la retraite progressive et possibilité de modification
La pension partielle est calculée sur la base de la pension à laquelle aurait droit le.la fonctionnaire s’il.elle faisait valoir ses droits à pension à la date du début de sa retraite progressive, base qui reste identique tout au long du dispositif. Le montant obtenu est ensuite proratisé en rapport de la quotité non travaillée (de 10 à 50%).
Lorsque la quotité du temps partiel varie à la hausse ou à la baisse, le montant de la pension partielle varie au regard de la nouvelle quotité non travaillée. Le montant de base reste celui calculé lors de la demande initiale.
La pension partielle est due ou modifiée à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les conditions sont réunies ou modifiées. A moins que celles-ci soient réunies ou modifiées le premier jour du mois, auquel cas elle est versée dès cette date.
Lorsqu’il est mis fin au dispositif, quelle qu’en soit la raison, le versement prend fin de la même manière au premier jour du mois suivant la date de fin du dispositif.
Fin du dispositif
Elle est engagée lors :
- a) de la reprise à temps plein de l’agent.e ;
- b) de la suppression unilatérale de l’autorisation de travail à TP par l’administration ;
- c) du départ à la retraite.
NB: pour les points (a) et (b) la reprise à plein temps implique la perte du droit à réactiver le dispositif. En effet, le décret ne différencie pas ces deux situations.
Prise en compte de la période de la retraite progressive dans le calcul de la pension
Le temps passé en retraite progressive est pris en compte pour le calcul de la pension :
- pour la totalité de la durée en trimestres d’assurance tous régimes (pour le calcul de la décote ou surcote) ;
- au prorata du temps travaillé pour les trimestres cotisés (il est toujours possible de surcotiser… dans les conditions que l’on connaît). Si durant la période de retraite progressive plusieurs quotités de TP sont appliquées, chaque “droit à trimestres” sera proratisé.
Exemple : Un collègue a connu 2 périodes de quotité de temps partiel durant sa retraite progressive qui a duré 2 ans : 1 année à 50% puis 1 année à 75 % . La première période lui donne 2 trimestres (4 trimestres x 50%) de cotisation, la deuxième 3 trimestres (4 trimestres x 75%) soit au total 5 trimestres de cotisation. La durée d’assurance ne subit aucune proratisation, soit 8 trimestres.
Quelques précisions
Le bénéfice du dispositif “retraite progressive” :
- est ouvert à toutes les formes de dépassement de l’âge limite (70 ans pour la catégorie sédentaire désormais et 67 ans pour les anciens catégorie active), qu’il s’agisse d’une demande simple, pour enfant à charge, … ; autrement dit, il n’y a aucune obligation à prendre sa retraite à l’âge d’ouverture des droits à retraite, les agent·es pourront rester dans le dispositif de retraite progressive jusqu’à l’âge limite et même au-delà s’ils et elles remplissent les conditions de dépassement de la limite d’âge.
- peut permettre d’engendrer de la surcote ;
- n’est pas compatible avec une activité accessoire (cumul d’activité) ;
- est mobilisable lors d’un temps incomplet, la condition d’obtention d’un temps partiel n’est pas opposable aux agent.es à temps incomplet ;
- n’est pas mobilisable pour un TP thérapeuthique.
Les enseignant·es contractuel·les et les AESH sont affilié·es au régime général et bénéficiaient, avant la réforme, de ce dispositif.
Notre analyse
Pour les enseignant·es, ce dispositif est entièrement assujetti à l’obtention d’un temps partiel, c’est donc l’une des pierres angulaires à l’intervention syndicale. Dans une période d’insuffisance de personnels, il y a lieu de se prémunir contre tout “procès en favoritisme” de telle ou telle catégorie de personnels en fonction de l’âge.
La FSU-SNUipp revendique que :
- le temps partiel pour retraite progressive devienne un temps partiel de droit sans réduire la possibilité d’obtenir, pour les autres personnels, un temps partiel sur autorisation.
- la cotisation à temps plein soit financée par l’employeur.
- la retraite progressive puisse être obtenue 5 ans avant le départ et sans condition de trimestres cotisés.
- le montant de la pension partielle doive donner lieu à un nouveau calcul annuel pour prendre en compte les nouveaux trimestres cotisés ou les évolutions dans la carrière (promotion, augmentation salariale, …).
- La délégation de mission imposée par certaines collectivités aux directeur·trices n’empêche pas l’obtention d’une retraite progressive.